Faut-il supprimer l’aide juridictionnelle aux auteurs d’actes terroristes ?
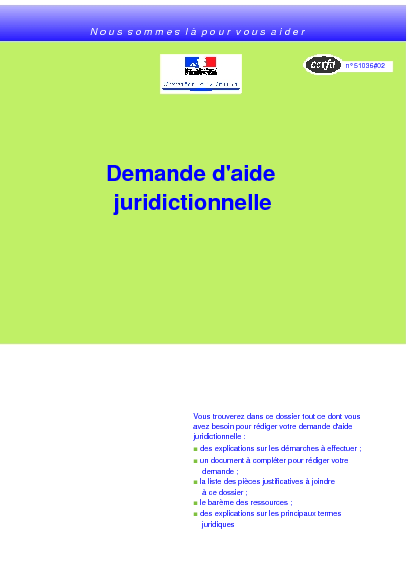
À n’en pas douter, le terrorisme stimule l’inventivité du législateur. Ce dernier s’affranchit sans embarras de principes parfois constitutionnels pour réduire à peau de chagrin les droits des personnes suspectées de terrorisme, et de celles condamnées pour le même motif. C’est précisément le sens d’une proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 12 avril 2018 visant à supprimer l’aide juridictionnelle aux auteurs d’actes terroristes.
La proposition est fondée sur l’idée qu’un État de droit « n’a pas vocation à être schizophrène ou masochiste » et qu’« offrir à ceux qui menacent notre pays des droits financés par la collectivité n’est pas acceptable pour les citoyens et contribuables. » Ainsi, lorsque le bénéficiaire aurait été définitivement condamné pour un acte de nature terroriste, tel que défini au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal, intitulé « Des actes de terrorisme », l’aide juridique devrait lui être retirée.
Il convient de rappeler que, selon la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide juridictionnelle correspondant à la prise en charge totale ou partielle par l’État des frais engagés en raison de la procédure (dont les frais d’avocat).
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré dans certains cas limitativement énumérés par l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 (si le bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ; si le bénéficiaire de l’aide obtient gain de cause dans des conditions qui ne le rendrait plus éligible à obtenir cette aide ; en cas de retour à meilleure fortune de la personne, ou lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire a été jugée dilatoire ou abusive). Le retrait implique l’obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l’État.
Il sera question donc, pour le législateur, d’introduire un nouveau motif de retrait tenant à la culpabilité du demandeur s’agissant spécifiquement des actes de terrorisme et à l’exclusion, pour l’instant, de toute autre infraction. La condition inédite qu’il établirait serait donc non seulement méritoire, puisque le retrait serait entrainé par la décision de culpabilité, mais également fonction de la nature de l’infraction, et non plus simplement des ressources ou de la bonne foi du bénéficiaire.
Nous savons que le terrorisme a pour effet de s’attaquer à certaines valeurs sociales protégées par le code pénal, telle que l’intégrité physique des personnes, mais il a surtout pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. C’est ce dernier aspect qui constitue la singularité du terrorisme par rapport à d’autres crimes ou délits. Il est indéniable que l’aide juridictionnelle n’a pas nécessairement pour vocation à faire bénéficier des individus qui se sont érigés en tant qu’ennemis d’un État finançant lui-même cette assistance. Anticipant une éventuelle polémique à ce sujet, notre confrère Dupond-Moretti avait renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour le procès de Monsieur Abdelkader Merah. Cette sanction, d’ordre symbolique, n’est cependant pas justifiée en raison des obstacles juridiques qu’elle soulève (indépendamment de la question éventuelle du repentir), et que le prétexte ne permet pas de neutraliser.
Tout d’abord, une différenciation serait ainsi induite avec le restant des infractions contre les personnes, dont celles prévues par le livre II du code pénal (actes de barbarie, agressions sexuelles), lorsque ces dernières ne seraient pas liées à des actes de terrorisme.
Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». La distinction introduite par le législateur conduirait en pratique à une rupture d’égalité entre les personnes condamnées pour terrorisme, et les autres. Il est improbable que la singularité du terrorisme puisse à elle seule justifier une dérogation à ce principe qui possède une valeur constitutionnelle (Cons. const. 23 juill. 1974, n° 75-56 DC).
Dans un second temps, le législateur pourrait donc être tenté d’étendre le retrait à d’autres infractions qu’il estimerait d’une particulière gravité, ce qui reviendrait à remettre en cause le sens même de l’aide juridictionnelle.
Ensuite, selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente et a le droit de se défendre elle-même, ou d’être assistée par un défenseur de son choix et, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat commis d’office. Certaines personnes, par crainte d’être condamnées, pourraient ainsi renoncer à demander l’aide juridictionnelle, ce qui fausserait le principe du droit à la défense, et donc l’application de l’article cité supra.
Enfin, l’accès à la justice est reconnu comme un droit fondamental, dont l’aide juridictionnelle garantit l’intégrité. Son retrait, aujourd’hui appliqué aux actes liés au terrorisme, et probablement demain à d’autres infractions, affaiblirait ce droit fondamental sans incidence pratique notable.
L’infraction qualifiée d’acte de terrorisme obéit déjà à un régime dérogatoire. Le législateur doit veiller à ne pas déstructurer et disproportionner le restant du droit au prétexte de satisfaire une requête populaire.
Dalloz actualité, Edition du 27 mars 2019
Par Vincent Brengarth
Le 17 Mai 2018